La
comète du siècle
McNaught C/2006 P1
Emmanuël Jehin [1, 2] et Jean Manfroid
[1]
1. Institut d'Astrophyisque et de Géophysique de l'Université de
Liège
2. Observatoire Européen Austral (ESO)
Article paru dans
la revue le Ciel (février 2007) de la Société astronomique
de Liège (SAL)
et dans le bulletin du Groupe Astronomie de Spa
(GAS).
C’est dans une désolante apathie médiatique que s’est
déroulé l’un des spectacles les plus grandioses de
la nature, une manifestation céleste qui aurait fait trembler les
anciens et dans laquelle ils auraient vu l’annonce d’événements
glorieux ou de terribles catastrophes. Peut-être manquait-il un sponsor
cigarettier à la comète C/2006 P1 McNaught ?
Cette comète a été découverte par Robert H.
McNaught le 7 août 2006 avec le télescope Schmidt « Uppsala » de
50 cm de l’observatoire de Siding Spring, en Australie. C’est
la 29e comète découverte au moyen du Schmidt Uppsala depuis
le début 2004 dans le cadre du projet Siding Spring Survey, un recensement
d’astéroïdes potentiellement dangereux. Grâce à ce
télescope et à deux autres se trouvant en Arizona, pas moins
de 400 astéroïdes pouvant s’approcher de la Terre (Near
Earth Asteroids, NEA) ont été découverts en 2006.
Pour R.H. McNaught, il s’agit de sa 31e comète !
 |
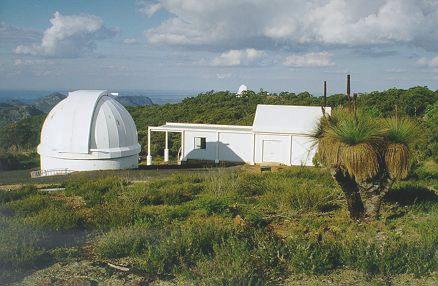 |
Première image de C/2006 P1. La comète était de magnitude 17.3 et montrait une faible coma de 20 secondes d'arc de diamètre. Le champ fait 13 minutes d'arc de largeur. Pose de 20 secondes, le 7 août 2006 avec le Schmidt de 20 pouces de Siding Spring (sous la coupole). |
|
C/2006 P1 est une « nouvelle » comète venant directement
du nuage de Oort. Pour les astronomes, elle est donc plutôt semblable à la
comète Hale-Bopp (C/1995 O1) qu’à 1P/Halley par exemple,
qui est périodique. Mais peut-être reviendra-t-elle dans des
milliers d’années ?
Très faible lors de sa découverte, l’éclat de
C/2006 P1 s’est progressivement accru mais il n’atteignait
pas encore la 8e magnitude lorsque, s’approchant du Soleil, la comète
se perdit dans le crépuscule en novembre. Toutes les hypothèses étaient
alors envisagées. Reverrait-on la comète en janvier lorsqu’elle
se serait dégagée angulairement du Soleil, ou aurait-elle
disparu, évaporée sous la chaleur de l’astre du jour…
La comète fut retrouvée dès la fin de l’année
plus brillante que prévue aux alentours de la magnitude 4 et, à la surprise
générale, son éclat augmentait de jour en jour tandis
que sa trajectoire l’amenait au périhélie. A la mi-janvier
elle est passée très près du Soleil, à 0,17
unité astronomique, soit deux fois plus près de l’astre
du jour que Mercure, et on notait une magnitude de -4 ou -5. Cette brillance étonnante
est évidemment due principalement à l’augmentation
d’activité provoquée par l’intense rayonnement
solaire. Mais un autre phénomène est entré en jeu,
bien connu des ménagères, et qui rend visibles les poussières à contre-jour.
Cet effet de « forward scattering » ou « diffusion vers
l’avant » a peut-être fait gagner de précieuses
magnitudes à McNaught jusqu’à la rendre assez facilement
visible en plein jour avec une magnitude surpassant celle de Vénus.
Avant le périhélie, la comète était bien placée
en soirée pour les observateurs de l’hémisphère
nord. À condition bien sûr de ne pas avoir un horizon bouché,
car elle restait très basse sur l’horizon (moins de 10 degrés). À condition
aussi de ne pas profiter des dépressions qui ont continuellement
rempli le ciel belge d’une épaisse couche nuageuse...
De fait,
dans nos régions, le ciel est resté obstinément couvert.
L’évolution de la comète n’a pu être suivie
que grâce aux observations faites depuis d’autres pays, ou
par des télescopes spatiaux lorsque la comète était
au voisinage du Soleil.
De jolies images ont pu être obtenues depuis la région de
Munich à l’occasion de brèves éclaircies (nous
présentons ci-dessous des images fournies par Jean-Luc Dighaye
d’EurAstro,
et par Martin Dietzel depuis le siège de l’ESO).

Le 9 janvier en début de soirée,
quelques éclaircies apparues dans le ciel de Munich permirent à C.Poizat
et J.L. Dighaye
d'observer la comète qui se couchait en jouant à cache-cache
avec les nuages. Magnitude estimée aux environs de -2.
Nikon D100,
550mm f/6.3 Maksutov, ISO 200, poses de 1/8s à 1/2s.

Le 10 janvier, toujours depuis Munich, la comète
put être apercue épisodiquement.
Cette pose de 1.5s a été prise
par Martin Dietzel avec un Canon EOS 10D muni d'un télé de
400mm à f/5.6.
Comme pour toutes les images présentées
ici, aucun guidage spécifique n'a été utilisé.
J.-L. Dighaye note que la comète était aisément visible
en plein jour aux jumelles et, finalement, à l’œil nu
le 13 janvier une demi-heure avant le coucher du Soleil. La magnitude était
estimée à -5 ou -6. La faible élongation par rapport
au Soleil la rendait cependant moins spectaculaire que les jours précédents
après le coucher du Soleil.

Autres vues de la comète le 10 janvier
par Jean-Luc Dighaye
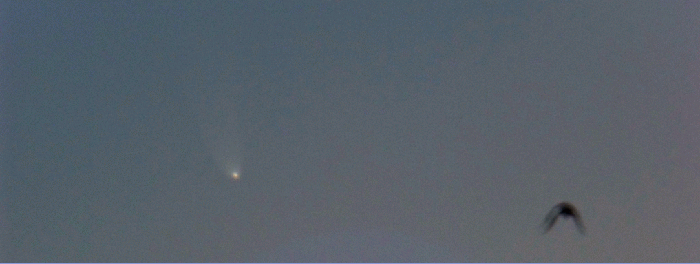
Le 13 janvier, la comète était visible
aux jumelles durant la journée et
est devenue visible à l'oeil
nu 1/2 heure avant le coucher du Soleil.
Photo depuis Munich par Jean-Luc Dighaye (Nikon D100 avec un télé de
550mm à f/6.3 Maksutov)
C’était alors le moment de s’intéresser
aux observations depuis l’espace. Là, pas de problème
de météo
mais les plus puissants observatoires spatiaux tels que Hubble (HST)
et Spitzer sont incapables d’observer près du Soleil. Heureusement,
plusieurs télescopes destinés à l’étude
du Soleil ont pu apercevoir la visiteuse.
Le vénérable observatoire solaire SOHO (NASA/ESA) est en
fait un habitué des comètes. Il s’agit d’ailleurs
du plus grand chasseur de comètes de tous les temps avec déjà plus
de 1200 découvertes à son actif – découvertes
généralement faites par des amateurs qui scrutent les images
SOHO publiées sur le web. Habituellement ce ne sont que de petites
comètes frôlant le Soleil, ou s’y précipitant
et, pour la plupart, elles font partie des débris d’une
ou l’autre grosse comète qui s’est fragmentée
il y a quelques siècles en passant très près du
Soleil. Les comètes « sungrazers » du groupe de Kreutz
en sont l’exemple le plus frappant. Parfois, la chance permet de
capturer un plus gros gibier, comme la comète NEAT C/2002 V1 en
2003 ou 96P Machholz en 2002.
Ce fut aussi le cas pour notre comète qui traversa le champ du
coronographe LASCO 3 de SOHO du 12 au 16 janvier avec en prime, le 14,
une conjonction de la planète Mercure
(voir image ci-dessous).
La comète était tellement brillante que l'image de McNaught est
fortement saturée (ce qui se remarque à la
ligne horizontale, une espèce de moustache, barrant le noyau),
preuve de l’éclat extrême de la nouvelle comète.
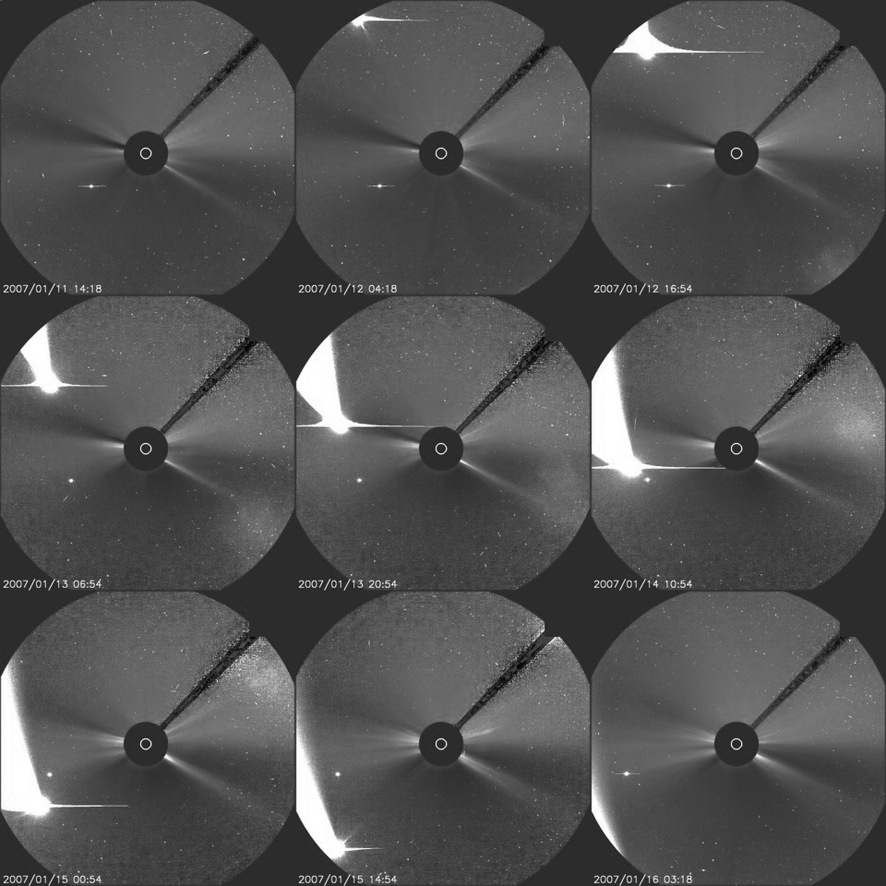 La
comète McNaught traverse le champ du coronographe LASCO 3 de SOHO
du 12 au 16 janvier 2007.
La
comète McNaught traverse le champ du coronographe LASCO 3 de SOHO
du 12 au 16 janvier 2007.
Voir aussi l'animation
suivante (@SOHO/NASA).
Un nouvel observatoire spatial solaire de la NASA,
STEREO, a fait ses premières
armes avec une image de la comète. En effet la toute première
image prise par son « imageur héliosphérique » SECCHI-HI,
le 11 janvier, a révélé l’astre chevelu dans
toute sa splendeur. Cette caméra observe l’espace entre la
Terre et le Soleil afin de déceler des tempêtes solaire pouvant
menacer notre planète. Sur cette image, la queue de la comète
s’étend sur 7 degrés et présente une série
de stries, préfigurant l’évolution qu’elle allait
connaître ensuite.
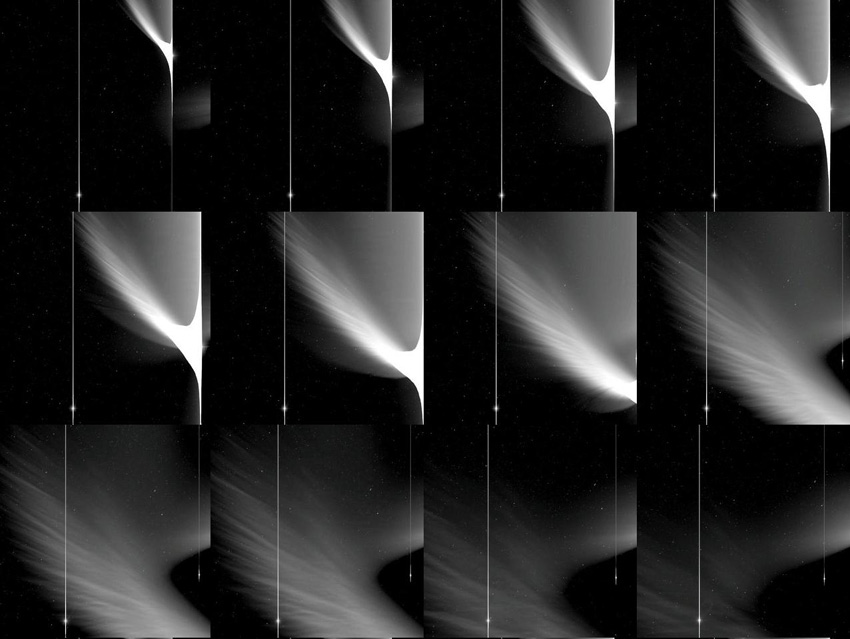
Vue de la comète entre le 11 et le 18 janvier par la caméra SECCHI-HI
de l'observatoire
spatial STEREO. La queue de la comète présente des stries très
prononcées.
Voir aussi l'animation
spectaculaire de ce passage.
Après le passage au périhélie, ce fut au tour des
observateurs de l’hémisphère sud de profiter du spectacle.
Et quel spectacle ! Repérée en plein jour par un des auteurs
(EJ) avec des jumelles le 15 janvier depuis Paranal, elle fut visible à l’œil
nu le lendemain quelques minutes après le coucher du Soleil, jouant à cache-cache
avec de malheureux nuages présents au-dessus du Pacifique. Le
17 janvier, sa brillance dans le ciel crépusculaire augurait d’un événement
exceptionnel. Il s’était formé tout un éventail
de queues.
Les premières soirées, seule leur extrémité dépassait
de l’horizon car le noyau était trop près du Soleil.
Ces draperies faisaient penser à une aurore polaire. En s’écartant
du Soleil, la comète devint visible dans son entièreté les
nuits suivantes et dévoilait son extraordinaire parure.
Telle une aurore boréale, une multitude
de queues apparaissent clairement le 18 janvier dans le ciel noircissant
de Paranal,
une vingtaine de minutes après le coucher de la comète
sur l'Océan Pacifique.
Canon ESO 350D, 35mm zoom à f/4,5, 30secondes de pose à 1600 ISO
(@ Emmanuël Jehin)
À partir du 19 janvier, la comète pouvait en effet être
observée de plus en plus longtemps dans un ciel presque totalement
noir. Le spectacle était alors magnifique : la queue de la
comète,
fortement courbée et présentant un fort gradiant de
brillance, s’étendait sur plus de 30 degrés pour
toucher de nouveau l’horizon ! La structure complexe de la
queue est tout à fait
remarquable avec ces nombreux « rayons » régulièrement
espacés, visibles à l’œil nu dès
que le ciel était assez noir.
Le 20 janvier, c’est une conjonction
rapprochée entre un croissant de Lune de deux jours et Vénus
qui est venu s’ajouter au décor... Un spectacle bien
calculé dont
seule la nature à le secret. Quelques jours plus tard, la
Lune croissante est devenue de plus en plus gênante, effaçant
progressivement les délicates volutes des parties les plus
lointaines et faibles de la queue. D’autant plus que la comète
s’éloignait
chaque jour un peu plus du Soleil et de la Terre (perdant environ
0.5 magnitude par jour).
Les photos d’après le périhélie que nous présentons
ci-dessous ont été prises par Emmanuël Jehin depuis l’observatoire
de l’ESO de Cerro Paranal situé à 2500 m d’altitude
dans le désert de l’Atacama.
La comète se déploie
majestueusement le 18 janvier au dessus d'un des "petits" télescopes
auxiliaires (AT pour Auxiliary Telescope) du VLTI (l'interféromètre
du VLT). Ces télescopes ont été construits par
la firme liégeoise AMOS. Vénus se couche au dessus de
la passerelle d'accès à la plateforme où se trouvent
les télescopes.
Canon EOS 350D, 35mm zoom à f/5,0, 30 secondes de pose à 400
ISO. (@ Emmanuël Jehin)
Photo réalisée le 20 janvier depuis
la plateforme du VLT. La Lune est en conjonction avec la queue de la
comète. Vénus vient de se coucher.
Deux AT du VLTI ainsi que le réseau de rails sur lesquels ils se déplacent
sont visibles sur cette image.
Canon ESO 350D, 18mm zoom à f/3,5, 72 secondes de pose à 1600
ISO. (@ Emmanuël Jehin)
Photo réalisée le 21 janvier depuis le site du nouveau télescope
infrarouge à grand champ (VISTA) de l'ESO, situé à 2km à l'est
de Cerro Paranal.
La couche de nuages qui recouvrent presque continuellement l'océan est
bien visible, grâce à l'éclairage de la Lune.
Canon EOS 350D, 20mm zoom à f/4,5, 80 secondes de pose à 1600
ISO. (@Emmanuël Jehin)
Des comètes présentant plusieurs
queues ont déjà été observées par
le passé, la plus célèbre étant sans doute
celle de 1744 (de Chéseaux) pour laquelle la comparaison avec
une aurore avait aussi été évoquée. L’origine
de la multiplicité des queues était cependant mystérieuse.

Le dessin d'époque ne rend certainement
pas justice
à la comète de Chéseaux de 1744 et ses
multiples queues
Plus près de nous, la comète West en 1976 (voir image ci-dessous)
avait montré une queue étalée avec de nombreuses stries.
Au cours du XXe siècle,
les comètes Seki-Lines 1962 II, Mrkos 1957 V ainsi que la grande comète
1910 I avaient suscité la
curiosité avec des appendices analogues. On comprend maintenant mieux
la formation de ces structures.
Plusieurs phénomènes sont en jeu. Il y a bien sûr le fait
que, tournant vite autour du Soleil, les jets émis par le noyau prennent
successivement des directions différentes. La rotation du noyau sur lui-même
intervient donc puisque l'activité des
sources est contrôlée par le rythme jour-nuit de la comète.
Une fois éjectée,
les poussières sont soumises aux lois de la mécanique céleste,
c'est-à-dire à la
force de gravitation, mais aussi à des forces non gravitationnelles comme
la pression de rayonnement et celle du vent solaire. Plus les poussières
sont fines, plus l'influence de ces forces non gravitationnelle est importante.
Il apparaît ainsi une ségrégation
des grains de poussière en fonction de leur masse. L'effet est d'autant
plus complexe qu'intervient la désagrégation progressive des grosses
particules en poussières
de plus en plus fines dont les mouvements sont différents. La fragmentation
de gros grains le long de leur trajectoire serait ainsi à l'origine de
stries inclinées par rapport à la
queue générale. L'explication détaillée du phénomène
reste cependant à établir.
Le caractère exceptionnel
de cette comète apparaît lorsqu’on la compare aux
plus belles comètes des derniers siècles. La comète
de 1744 dont nous avons parlé a atteint la magnitude –7
et était visible en plein jour. Comme McNaught, c’est
quelques jours après le périhélie qu’elle
a montré une demi-douzaine de queues. Il s’agit donc peut-être
de l’astre que l’on peut le mieux comparer à McNaught.
En 1976, la comète West a montré une queue très large, mais
moins structurée que McNaught. Elle n’a pas non plus atteint une
magnitude comparable de sorte qu’on doit remonter à 1965, avec la
fameuse comète Ikeya-Seki, pour trouver un astre plus brillant. Son noyau
a peut-être frôlé la magnitude –15 et était visible
sans difficulté en plein jour. Au lieu d’un éventail, cette
comète présentait une très longue queue torsadée.
L’aspect offert par une comète peut dépendre d’une
foule de paramètres comme l’orientation de l’axe de rotation
du noyau et la position des sources des jets à sa surface, ainsi que de
la position de la Terre par rapport à l’orbite.
 |
 |
En 1976, la comète West (C/1975 V1) montrait aussi une queue striée. Photo réalisée au début du mois de mars 1976 par Peter Stättmayer depuis Munich (Allemagne) |
|
Ikeya-Seki fut probablement la plus brillante
des comètes du xxe siècle mais deux autres, en 1910 et
1927, n’étaient pas loin derrière. Enfin, remontant
un peu plus loin, on ne peut manquer de parler de la comète
de septembre 1882 qui, semble-t-il, doit être classée
dans une catégorie à part de super-comètes, tant
elle était exceptionnelle. On parla, peut-être avec une
certaine exagération, d’une magnitude de -20. Un tel astre
attirerait-il de nos jours l’attention de nos médias ?
 |
 |
La comète Ikeya-Seki, phototgraphiée par Dr Roger Lynds en 1965 |
|
L’extension de la queue était considérable et, en s’incurvant
vers le nord, ses extrémités atteignaient les zones visibles
depuis l’hémisphère nord, ce qui était tout à fait
inattendu. C’est ainsi que les pseudo-aurores avaient pu être
photographiées depuis le Colorado dès le 17 janvier. Ensuite,
pendant plusieurs jours, des observateurs de l’hémisphère
boréal s’évertuèrent à voir le bout des
queues de la comète. Il fallait des sites d’altitude et un
ciel d’une grande pureté pour distinguer ainsi quelques
bandes.
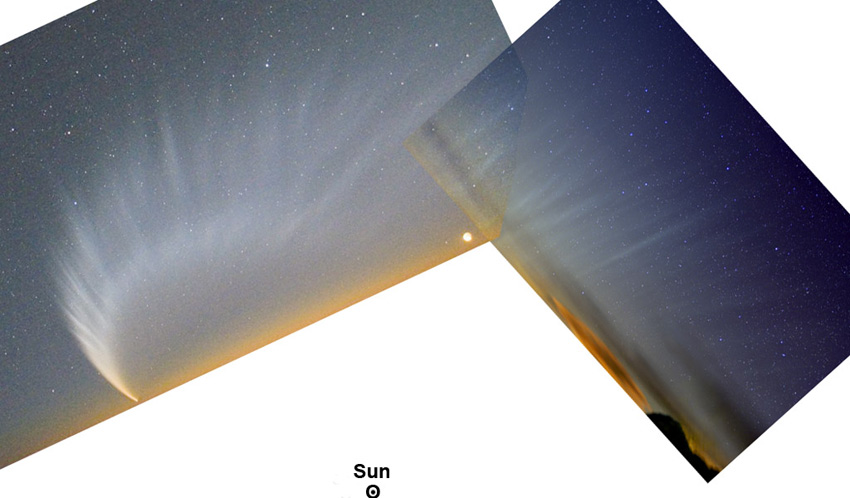
Composition de deux photos de la comète
McNaught prises le 20 janvier 2007 depuis Cerro Paranal dans l'hémisphère
sud (à gauche, par S. Deiries,
ESO) et le 19 janvier depuis les Alpes de Carnic, en Italie dans l'hémisphère
nord (à droite,
par M. Fulle, APOD le
24 janvier). La queue était si grande qu'elle était visible des
deux hémisphères. L'image couvre 65 degrés en déclinaison,
de -50 degrés Sud (constellation
de la Grue) à +15 degrés Nord dans Pégase (à droite), équivalent à environ
150 millions de kilomètres, soit environ la distance de la Terre au Soleil.
La Grande Comète de 2007 s’éloigne maintenant, mais
au moment où nous écrivons ces lignes elle reste encore bien
visible pour l’hémisphère sud, et ce malgré la
Lune ou, dans une certaine mesure, les lumières urbaines.

La comète vue depuis les hauteurs de Santiago
du Chili.
© Stéphane Guisard, www.astrosurf.com/sguisard
Au grand dam des astronomes,
lorsqu’elle resplendissait de tous ses
feux, la comète a toujours été trop basse pour être
observée avec les grands télescopes.
Si de superbes images
ont pu être obtenues, les spécialistes auraient bien aimé pouvoir
profiter des équipements sophistiqués du VLT par exemple,
pour dévoiler les secrets de ces astres qui restent encore bien
mystérieux.
 Quelques
liens où admirer la comète :
Quelques
liens où admirer la comète :
- McNaught depuis Paranal :
http://www.groupeastronomiespa.be/mcnaught/
- McNaught depuis Siding-Spring :
http://msowww.anu.edu.au/~rmn/C2006P1new.htm
http://members.ozemail.com.au/~loomberah/mcnaught.htm
- Galeries photo à travers le monde :
http://www.spaceweather.com/comets/gallery_mcnaught.php
http://skytonight.com/community/gallery/skyevents/5129766.html
- Les photos depuis l’ESO :
http://www.eso.org/outreach/press-rel/pr-2007/pr-05-07.html
- Observations scientifiques de McNaught au NTT (La Silla)
par les auteurs et collaborateurs
(ESO PR):
http://www.eso.org/outreach/press-rel/pr-2007/pr-07-07.html
- Gary Kronk's cometography :
http://cometography.com/lcomets/2006p1.html
- Seiichi Yoshida's McNaught webpage :
http://www.aerith.net/comet/catalog/2006P1/2006P1.html
- McNaught passe près du Soleil : le film de SOHO sur
APOD :
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap070120.html
- Les grandes comètes du passé :
http://cometography.com/past_comets.html